En août 2023, le groupe de ransomware Akira aurait compromis les systèmes informatiques de KNP Logistics, une entreprise de transports britannique historique fondée en 1865. Une intrusion rendue possible par un mot de passe faible qu’un hacker a pu facilement deviner. Ce détail, en apparence anodin, s’est transformé en point d’entrée fatal.
Les conséquences ont été dévastatrices : activités paralysées, serveurs chiffrés, opérations gelées. Malgré une infrastructure sécurisée conforme aux normes de la branche KNP n’a jamais pu relancer son activité. L’entreprise a été placée en redressement, puis liquidée. Dans les mois qui ont suivi l’attaque une société plus que centenaire a été rayée du paysage économique britannique. Une faillite industrielle provoquée par une simple négligence de sécurité.
Table des matières
ToggleUne entreprise centenaire paralysée en quelques clics
Fondée à l’époque victorienne, KNP Logistics et sa filiale historique Knights of Old, gérait plus de 500 camions à travers le Royaume-Uni. Le groupe assurait la logistique pour des clients majeurs de l’industrie et du retail. L’attaque, survenue en juin 2023, a interrompu brutalement des décennies d’activité continue.
Selon le témoignage du directeur général Paul Abbott dans un documentaire BBC Panorama diffusé le 21 juillet 2025, l’origine de l’intrusion remonte à l’exploitation d’un identifiant compromis appartenant à un employé. Le mot de passe, peu sécurisé et simple à trouver, a permis aux pirates informatiques d’accéder au système. Une fois le compte infiltré, les attaquants ont étendu leur accès latéralement, accédant aux serveurs de production sans déclencher d’alerte. Cette négligence apparemment mineure s’est révélée être le point de basculement fatal qui a provoqué l’effondrement de l’entreprise centenaire.

Le chiffrement des données s’est opéré en quelques heures. Les sauvegardes locales ont été ciblées puis effacées. Privée de ses informations logistiques et comptables, KNP s’est retrouvée dans l’incapacité d’honorer ses contrats, d’assurer ses livraisons et de gérer ses flux financiers. Malgré une tentative de relance partielle des opérations, la structure n’a pas résisté au choc : le 25 septembre 2023, après trois mois de paralysie et de tentatives de sauvetage, le groupe se voit contraint à un dépôt de bilan.
L’impact social a été considérable. Près de 700 salariés ont été licenciés, les partenaires industriels se sont retrouvés sans prestataire logistique, et plusieurs clients ont dû réorganiser leurs chaînes d’approvisionnement en urgence. Une entreprise vieille de 158 ans, fleuron du secteur du transport de marchandises britannique, a été balayée par un ransomware sans même qu’une faille technique soit exploitée.
L’illusion de la sécurité : quand tout semble en place
D’après les informations relayées par la BBC, KNP Logistics disposait d’un socle de sécurité informatique conforme aux standards du secteur : antivirus, pare-feux, procédures de sauvegarde, outils de supervision. L’entreprise avait même souscrit une assurance cyber, censée la couvrir en cas d’incident majeur.
Mais aucune de ces mesures n’a empêché la compromission initiale. Aucun système n’a détecté l’accès frauduleux. Aucune alerte ne s’est déclenchée lors du déplacement latéral des assaillants à travers l’infrastructure. Et lorsque le chiffrement a commencé, il était déjà trop tard.
Des experts en cybersécurité ont souligné que l’absence d’authentification multifacteur (MFA) a probablement été un facteur déterminant. Cette faille peut permettre à des attaquants d’exploiter une simple faiblesse d’identification pour pénétrer dans les systèmes et s’y déplacer sans être détectés.
Le cas KNP montre combien la confiance excessive dans une sécurité “par défaut” peut se révéler destructrice. Même les entreprises correctement équipées peuvent échouer à détecter une compromission élémentaire, surtout lorsqu’elle s’appuie sur des techniques simples et silencieuses.
Le piège du paiement : une promesse vide de garantie
Dès que les fichiers ont été chiffrés, une rançon a été exigée. Le montant – estimé à plusieurs millions de livres sterling – était censé débloquer les données à l’aide d’un décrypteur fourni par les attaquants. Mais dans les faits, rien ne garantissait que cet outil fonctionnerait, et l’entreprise n’avait pas les moyens de payer une telle somme. Selon la BBC, KNP n’a pas cédé au chantage, ce qui a contribué à la perte définitive de ses données.
Cette situation illustre un dilemme fréquent : même si une entreprise envisage de payer pour récupérer ses données, il n’y a aucune garantie que le décrypteur fonctionne correctement. Comme le montre notre étude de cas sur le ransomware Akira, les clés de déchiffrement obtenues auprès des attaquants sont parfois inutilisables : défaillantes, incomplètes, ou volontairement sabotées.
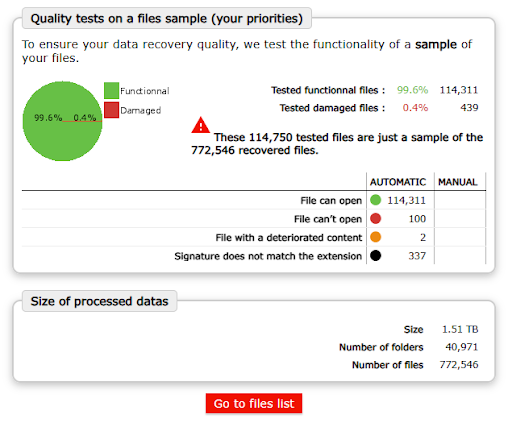
Le cas KNP rappelle que la promesse d’un décrypteur n’est qu’un levier de pression psychologique. Face à cette situation, les entreprises doivent évaluer toutes les options disponibles, y compris l’expertise technique indépendante pour identifier d’éventuelles voies de récupération.
L’ingénierie sociale : levier d’intrusion sous-estimé
Contrairement aux idées reçues, les groupes de ransomware n’ont pas toujours besoin de scripts sophistiqués ou de failles non corrigées pour compromettre un système. Dans le cas de KNP Logistics, c’est la réutilisation d’un mot de passe – déjà compromis lors d’une précédente fuite – qui a permis aux assaillants de s’introduire dans le réseau. Le mot de passe, récupéré dans une base de données en circulation sur des forums du dark web, était encore actif sur un compte utilisateur interne.
Une fois connectés, les cybercriminels ont utilisé des techniques d’ingénierie sociale pour contourner les contrôles internes : escalade de privilèges par abus de confiance, demandes de réinitialisation internes non vérifiées, observation des routines utilisateurs. Ces actions, souvent invisibles pour les dispositifs de détection traditionnels, s’appuient sur les automatismes humains plus que sur des vulnérabilités logicielles.
Les cybercriminels ne sont jamais à court d’imagination pour parvenir à leurs fins. Ainsi le groupe Interlock a dernièrement innové en utilisant la méthode FileFix, consistant à duper les utilisateurs via de faux fichiers au design soigné, intégrés dans des environnements familiers. Cette technique illustre parfaitement la montée en puissance des attaques qui ciblent non plus les failles techniques, mais les comportements humains prévisibles.
L’exploitation de la faille humaine n’est plus l’exception : elle devient la norme.
L’exemple révélateur de Clorox : quand l’ingénierie sociale cible le helpdesk
Un cas récent illustre cette vulnérabilité potentielle entre humains et processus organisationnels. L’entreprise Clorox a intenté une action en justice contre son prestataire informatique Cognizant, l’accusant d’avoir permis une cyberattaque majeure en août 2023 qui aurait causé 380 millions de dollars de dommages.
Selon les allégations de Clorox dans les documents judiciaires rendus publics un cybercriminel aurait simplement contacté par téléphone le service d’assistance informatique de Cognizant en se faisant passer pour un employé de Clorox. Et l’agent du helpdesk aurait réinitialisé les mots de passe et les authentifications multifacteurs (MFA) du compte demandé sans appliquer de procédure de vérification d’identité.
Ce cas montre comment la chaîne de sécurité, aussi robuste soit-elle techniquement, peut être compromise par son maillon le plus faible : l’humain et les processus qui encadrent ses actions. Les experts recommandent désormais de repenser l’architecture des systèmes de sécurité pour qu’ils imposent automatiquement les protocoles de vérification d’identité. Cette approche systémique, plutôt que de compter uniquement sur la formation des employés, rend les attaques d’ingénierie sociale considérablement plus difficiles à réussir.
Réagir vite : chaque heure compte
Lorsqu’une attaque par ransomware est détectée, le temps devient un facteur critique. Chaque minute d’inaction peut aggraver les dommages, rendant la récupération des données plus complexe, voire impossible.
Étapes immédiates à suivre :
- Isoler les systèmes affectés : déconnecter les machines compromises du réseau pour empêcher la propagation du malware.
- Préserver les preuves : éviter toute action pouvant altérer les journaux système ou les fichiers chiffrés, essentiels pour l’analyse post-incident.
- Contacter des experts en récupération de données : faire appel à des spécialistes capables d’intervenir rapidement pour évaluer la situation et proposer des solutions de récupération sans céder aux exigences des cybercriminels.
Une coordination efficace avec les autorités et les différents prestataires est également un atout indéniable pour évaluer l’étendue de l’attaque et mettre en œuvre les mesures de remédiation appropriées.
Repenser la sécurité : au-delà du mot de passe
Les méthodes d’authentification traditionnelles basées uniquement sur des mots de passe montrent leurs limites face aux menaces actuelles. Le modèle Zero Trust s’impose comme une réponse adaptée, reposant sur le principe de « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». Il implique une vérification systématique de chaque tentative d’accès, indépendamment de l’origine de la demande.
Par ailleurs, la stratégie de sauvegarde 3-2-1 reste une base solide : trois copies des données, sur deux types de supports différents, dont une conservée hors site. Pour renforcer cette approche, la règle 3-2-1-1-0 ajoute une copie immuable ou isolée (air gap) et exige des sauvegardes vérifiées sans erreur. Cette méthode offre une résilience accrue face aux ransomwares.
Pour renforcer la sécurité, les entreprises devraient envisager les mesures suivantes :
- Mise en place de l’authentification multifacteur (MFA) : ajouter une couche supplémentaire de sécurité en exigeant plusieurs formes de vérification.
- Sensibilisation du personnel : former les employés aux bonnes pratiques de cybersécurité pour réduire les risques liés à l’ingénierie sociale.
- Sauvegarde régulière des données : adopter la stratégie de sauvegarde 3-2-1, qui consiste à conserver trois copies des données sur deux supports différents, dont une hors site.
- Tests de restauration : vérifier régulièrement la capacité à restaurer les données à partir des sauvegardes.
- Élaboration d’un plan de réponse aux incidents : définir clairement les procédures à suivre en cas d’attaque, incluant les contacts internes et externes à mobiliser.
En combinant une authentification renforcée, une sensibilisation continue du personnel et des stratégies de sauvegarde robustes, les entreprises peuvent significativement réduire leur exposition aux cybermenaces.
Ce que nous enseigne l’affaire KNP
Le cas KNP Logistics agit comme un signal d’alarme. Une entreprise robuste, dotée d’une longue histoire, n’a pas survécu à une attaque rendue possible par un mot de passe compromis. Aucune infrastructure, aussi bien équipée soit-elle, n’est invulnérable lorsque la faille réside dans les usages humains.
Ce type d’incident ne se résume pas à une perte temporaire d’exploitation. Il menace directement la continuité d’activité, la réputation, les emplois et les relations commerciales. Si l’attaque a eu lieu, il est encore possible d’agir, à condition de savoir vers qui se tourner.
Notre rôle est précisément d’intervenir après l’attaque, lorsque tout semble perdu. En collaboration avec les équipes IT, nous analysons les systèmes chiffrés pour déterminer les options techniques de récupération.
Vous êtes confronté à une attaque par ransomware ?
Nos équipes peuvent vous accompagner pour récupérer vos données et limiter l’impact sur votre activité. Contactez-nous sans attendre.
